« La parole, je la veux là où elle s'arrête et là où elle commence. Dada est au cœur des paroles. [...] La parole, la parole, la parole en dehors de votre sphère, de votre air étouffant, de cette impuissance ridicule, de votre autosatisfaction stupidante, en dehors de cette ritournelle, de votre évidente étroitesse d'esprit. La parole, Messieurs, la parole est une affaire publique de premier ordre ». Hugo Ball[1]
« Belonging n'a pas de sujet » Stella Konstantinou
Dans son commentaire biblique sur Michée 4.6, Jean Calvin note : « Bien qu’il soit actuellement difficile de dire si l'Église est un homme mort ou invalide, il ne faut pas désespérer, car tout à coup le Seigneur relève les siens, comme s'il avait ressuscité des morts hors du tombeau. Il faut bien en tenir compte, car si l'Église ne brille pas, nous avons vite fait de la considérer comme éteinte et finie. Mais c'est ainsi que l'Église se maintient dans le monde, qu'elle se relève d'un coup de la mort, et qu'elle finit par se maintenir chaque jour au milieu de nombreux miracles de ce genre. Retenons que la vie de l'Église n'est pas sans résurrection, et plus encore : pas sans de nombreuses résurrections ».[2] L'étrange utilisation du terme « résurrection » au pluriel irrite non seulement le langage théologique courant, mais provoque également l'objection du correcteur orthographique utilisé pour rédiger ce billet. Ainsi, la situation de départ de l’avant-garde est déjà décrite en substance : un développement arrive à un point où « continuer » mène à une impasse sans espoir. En même temps, (1) il n'y a pas de clarté sur la direction à prendre et (2) l'urgence de la situation et des changements nécessaires n'est reconnue, partagée et soutenue que par une minorité.
Le terme « avant-garde » vient du langage militaire et désigne les troupes envoyée pour observer et explorer les territoires ennemis (en avant) afin de protéger les troupes qui suivent (garde). Carl von Clausewitz a souligné la fonction militaire et stratégique de l'avant-garde de la manière suivante : « Toute troupe qui n'est pas entièrement prête à la bataille a besoin d'une avant-garde pour apprendre et explorer l'approche de l'ennemi avant de l'apercevoir elle-même ».[3] En termes généraux, les avant-gardes forment des groupes ou des communautés qui se distinguent de la majorité ou du grand public par leurs rôles et leurs fonctions. Ils sont en avance sur leur temps, transgressent ses normes, ses règles et ses comportements et se distinguent par une agilité particulière, une grande créativité et des intentions subversives, voire subversives-révolutionnaires, dans un environnement hostile. Au XIXe siècle, le concept d'avant-garde s'est répandu dans l'art par le biais du saint-simonisme socio-philosophique. Le document fondateur de l'avant-garde historique est la « Manifeste du Futurisme » de Filippo Tommaso Marinetti, publié dans Le Figaro le 20 février 1909. Du XVIe au XXe siècle, le manifeste a constitué un acte souverain par lequel un prince ou un gouvernement communiquait au public des affaires importantes, notamment des déclarations de guerre. L'adaptation de ce type de document par les mouvements d'avant-garde s'accompagnait de la revendication « d’un rôle prépondérant, voire souverain, de l'art dans la réorganisation de la vie, de s'asseoir sur le siège des souverains, donnant aux représentants de cette avant-garde le quasi pouvoir de publier des manifestes ».[4]
Dès le début, Marinetti, juriste, écrivain, fondateur du futurisme italien et compagnon de route fasciste de Mussolini, n’a laissé planer aucun doute sur ses idées radicales. Les premières thèses de son manifeste fondateur sont les suivantes : « 1. nous voulons chanter l'amour du danger, l’habitude de l'énergie et de la témérité / 2. Les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l’audace et la révolte / 3. La littérature ayant jusqu’ici magnifié l’immobilité pensive, l’extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l’insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing ».[5] Contre les traditions culturelles (y compris leurs sources littéraires et leurs monuments architecturaux), le futurisme italien prônait une esthétique de la technique, de la vitesse, de l'énergie, de la puissance et du bruit des machines, et glorifiait la violence et la destruction militaires de la Première Guerre mondiale comme le prix nécessaire à payer pour de nouveaux modes de vie.
Le mouvement Dada, parti de Zurich, se rattache à la critique culturelle et artistique futuriste, intensifie sa critique du langage mais rejette systématiquement la glorification de la violence et le bellicisme. Tristan Tzara, éminent compagnon de Hugo Ball et Emmy Hennings à Zurich, déclarait : « Dada ; anéantissement de la logique, danse des impuissants de la création : [...] Dada ; abolition de la mémoire : Dada ; anéantissement de l'archéologie : Dada ; abolition des prophètes : Dada ; abolition du futur : Dada ; croyance absolue indiscutable dans chaque dieu produit immédiat de la spontanéité : Dada ; saut élégant et sans préjudice d'une harmonie à l’autre sphère ; trajectoire d'une parole jetée comme un disque cri ; respecter toutes les individualités dans leur folie du moment: sérieuse, craintive, timide, ardente, vigoureuse, décidée, enthousiaste ; peler église de tout accessoires inutil et lourd ; cracher comme une cascade lumière la pensée désobligente ou amoureuse, ou la choyer [...]. Liberté : Dada, Dada, Dada, hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences : La vie ».[6] Performances et poèmes sonores par lesquels le langage, la perception de la réalité, les normalisations sociales et culturelles se trouvent poussés à l’extrême et élargies de manière absurde et anarchique : les œuvres du dadaïsme sont devenues célèbres. L'art devient une provocation carnavalesque et (auto)ironique, une critique de la société, de la culture et de la morale.
Le surréalisme va encore plus loin en se tournant vers le psychisme, notamment grâce à l'étude de la psychanalyse. André Breton déclare dans son Manifeste du surréalisme de 1924 : « Je crois à la dissolution future de ces états apparemment si opposés du rêve et de la réalité dans une sorte de réalité absolue, si l'on peut s'exprimer ainsi : Surréalité. [...] SURREALISME, subst., m. - Automatisme psychique pur par lequel on cherche à exprimer, oralement ou par écrit, ou de toute autre manière, le déroulement réel de la pensée. Dictat de la pensée sans aucun contrôle de la raison, au-delà de toute considération esthétique ou éthique ».[7] Le surréalisme s'est fait connaître d'une part par la technique de l'écriture automatique, dans laquelle la formulation intentionnelle est remplacée par l'auto-efficacité de l'inconscient. D'autre part, le surréalisme exacerbe la critique épistémologique d'avant-garde sur la relation entre l'objet, le concept et la représentation, que René Magritte reprend dans son célèbre tableau « La Trahison des images » de 1929, où il accompagne la représentation d'une pipe de la légende « Ceci n'est pas une pipe ». Il s'agit d'une transgression onirique de la réalité, d'une transcendance du visible et d'une pratique librement associative et spontanée.
Malgré la pluralité, l'hétérogénéité et l'ouverture radicale des différents mouvements d’avant-gardes, des éléments, des méthodes et des stratégies récurrents se laissent reconnaître : (1) l’avant-garde est un mouvement, qui va à l'encontre de toute institutionnalisation et catégorisation ; (2) la rupture avec l'art comme secteur propre d’une société fonctionnellement différenciée ; (3) une impulsion politique critique, anarchiste ou révolutionnaire à l’égard de la société ; (4) le dépassement du système artistique, la critique du rôle exclusif de l'artiste et de l’exclusivité de son œuvre ; (5) l'union de l'art et de la réalité de la vie (cf. Joseph Beuys : « Chaque homme est un artiste »[8]) ; (6) la référence positive au développement technique et à la reproductibilité ; (7) la « pensée de l'immédiateté »[9] avec une résistance envers la permanence et la continuité et (8) la compréhension de soi comme précurseurs de développements futurs.
Il n'existe pas plus de « théologie de l'avant-garde » – comme le dit le titre de cet article – qu'il n'existe de discours établi sur la théologie ou sur l'Église et l'avant-garde. Contrairement aux arts, à la littérature, aux sciences de la culture et aux sciences sociales, la théologie ne dispose pas d'un concept systématique ou conceptuel d'avant-garde. Dans les plus de 2,3 millions d'entrées Google pour le terme de recherche « avant-garde », les rares références à des références théologiques et ecclésiales disparaissent sous la masse. Actuellement, seules trois publications contenant les deux termes dans leur titre apparaissent : l'étude théologique catholique de Jon Kirwan « An Avant-garde Theological Generation. The Nouvelle Théologie and the French Crisis of Modernity » (2018) et les deux monographies de la théologienne danoise Petra Carlsson Redell « Foucault, Art, and Radical Theology. The Mystery of Things » (2019) et « Avantgarde Art and Radical Material Theology. A Manifesto » (2021).[10] En outre, on trouve quelques publications contemporaines dans le contexte de la musique (religieuse) et de la liturgie.
Ce constat surprend, compte tenu du rôle particulier d'Israël dans la Bible à l’égard des nations et de la mission qui meut le christianisme primitif, celui-ci attribuant aux apôtres une fonction claire de précurseurs et de modèles dans et pour le monde. En outre, le vaste champ de la prophétie biblique, les eschatologies et l’apocalyptique, se caractérisent par le fait de poser un avertissement et un appel à la conversion qui est non seulement très en avance sur la réalité, mais qui entre aussi en conflit avec les points de vue et les convictions majoritaires et étatiques. En raison d’une réception manquante, on ne peut que spéculer sur l'abstinence théologique à l’égard de l’avant-garde. Indépendamment de l'implication historique et idéologique des Églises et des théologies à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle pour l’état actuel de l’Europe, quelques raisons objectives s'imposent : (1) le caractère d'avant-garde, de rupture et de transition, centre sur l’action immédiate et limité dans le temp, est diamétralement opposé à une conception institutionnelle de l'Église ; (2) l'athéisme rhétorique non dissimulé et un anticléricalisme abrupt – en tout cas à première vue ; (3) l'affinité de l’avant-garde avec les mouvements et les programmes politiques anarchistes, révolutionnaires et socialistes – inacceptables pour des Églises et des théologies qui offrent à l’État des ressources de légitimations; (4) la critique radicale du système, de la structure, de l'ordre et de la morale, qui incluait également la critique des Églises établies ; (5) l'anti-étatisme, la critique de la hiérarchie et le pathos égalitaire et démocratique, qui contredisaient la doctrine des deux règnes et la compréhension ecclésiale du ministère ; (6) le rejet systématique des autorités et de la tradition – un rejet qui ne s'arrêtait pas aux autorités religieuses ; et (7) un désintérêt notoire par rapport à la thématique (théologique) du salut.
Ces oppositions sont valables du point de vue des églises institutionnalisées et de leurs doctrines – mais il n’en est pas ainsi du point de vue de la prédication biblique et de la foi. Celles-ci constatent plutôt des affinités instructive avec l’avant-garde : (1) la déconstruction du sujet agissant par la critique du statut des artistes et l’affirmation d’une créativité sans intention : « Si je reconstruis le système de la Loi que j'ai détruit, je fais de moi un être qui transgresse la Loi.. [...] Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». (Gal 2,18.20) ; (2) le mouvement anti-institutionnel et le refus des systèmes de régulation dogmatiques :« Car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours ; nous recherchons celle qui est à venir » (Hé 13,14) ; (3) le souci de dépasser la dichotomie théorie-pratique et fin-moyen par une conception de la vie qui égalise tous les status, les normes et les valeurs :« Il n'y a plus ni Juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; en effet, vous êtes tous un, unis à Jésus Christ ». (Gal 3,28) ; (4.) la dynamisation de la dimension temporelle :« je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, et il n'y a plus de mer ». (Apocalypse 21.1) ; (5.) le motif de la dé- et recontextualisation de la perception, de l'expérience et du langage avec « Ils furent tous remplis de l'Esprit saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer ». (Actes 2.4) ou (6.) le fait de renoncer à toute localisation et l’affirmation d’être sans lieu propre :« Le Seigneur dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai ». (Gn 12,1)
Il n’est pas question ici d’une éventuelle proximité ou affinité (secrète) des mouvements d'avant-garde avec la théologie. La théologie des Églises établies est bien trop éloignée de l’inquiétude propre à l’avant-garde pour cela. Il s'agirait plutôt de se demander ce qui pourrait émaner des références bibliques que nous venons de citer en exemple, si elles n'étaient pas seulement interprétées et rendues compatibles avec un système de connaissance et de comportement prédéfini ou établi, mais si elles pouvaient développer une dynamique sauvage et spontanée, incontrôlée, et devenir ainsi réelles et donner naissance à une pratique.
La réflexion théologique sur l'avant-garde ne peut pas consister en une adaptation de sa propre théorie ou de sa propre pratique ecclésiale à un concept d'avant-garde ou à des fragments de ce mouvement. Le refus avant-gardiste de toute sorte de plans conceptuels et stratégiques, d'une part, et la conception d’une Église qui ne se donne pas elle-même sa mission et qui ne précède personne, mais qui suit le Christ, d'autre part, s'y opposent. Le lieu théologique de l'Église se trouve derrière le Christ qui la précède et devant le monde créé dans lequel l'Église existe. L'ordre de marche prédéfini de l'avant-garde d’un côté et de la suivance de l’autre n’immunise pas contre l’errance, comme le montrent les innombrables variantes de la marche de 40 ans dans le désert. C'est pourquoi l'Église a besoin – selon la déclaration de Calvin citée au début – de « beaucoup de résurrections », c'est-à-dire d'impulsions qu'elle ne peut pas produire elle-même et qu'elle ne peut pas se prescrire à elle-même.
En termes modernes, le réformateur genevois fait référence à une altérité constitutive de la foi chrétienne et de l'art. « L'étrangeté au monde est un moment de l'art ; celui qui le perçoit autrement que comme étranger ne le perçoit pas du tout ».[12] Malgré le fait d’être parfaitement ignare en la matière, comme il l’a lui-même reconnu, Karl Barth a clairement perçu la dimension dadaïste du travail théologique et le défi posé par cette dimension. Après avoir visité la deuxième exposition controversée du Moderner Bund au Kunsthaus de Zurich, au cours de laquelle un visiteur s'est bruyamment plaint des « barbouillages » (Schmierereien) exposé, Barth a relevé dans une lettre du 26 juillet 1912 à sa fiancée Nelly : « Les futuristes me sont devenus chers malgré moi [,] quand j'ai entendu cette critique. J'ai pensé à Messieurs Hüssy et aux autres personnes qui me sont chères dans le district de Zofingen. Mes sermons doivent vous paraître à peu près comme ces tableaux futuristes pour ce citoyen zurichois !!! Bien sûr, c'est différent, mais c'est la même ambiance : c'est de l'art, ce que j'appelle de l'art [,] et si vous faites autre, je souhaite alors que vous me remboursiez ».[13] Lorsque le théologien réfléchit à la doctrine de la prédestination dans l'Épître aux Romains, la critique que l'avant-garde adresse au langage s'impose à lui : « [c]ompte tenu de la réalité de ce Dieu, toutes nos notions religieuses et morales tombent les unes contre les autres comme des cônes posés sur la pointe, comme les maisons et les arbres d'un tableau futuriste ».[14]
La longue histoire des traditions théologiques et de leur enseignement a favorisé l'utilisation de formules, qui sont devenues étranges et incompréhensibles dès lors qu'elles ont été associées aux exigences de la critique historique et du regard scientifique. S’en est suivi un ensemble de questions qui paraissaient devenir incontournables, comme celle de savoir qui est ce Dieu « qui est tout autre » (Karl Barth) ou qui est « le tout autre » (Rudolf Bultmann), ou en quoi consiste « ce qui nous concerne absolument » (Paul Tillich), ou ce qui doit découler de la compréhension qu'il y a « un Dieu qui ‘existe’ [pas] » (Dietrich Bonhoeffer), ou en quoi les doctrines au sujet de Dieu et leur proclamation par l'Église se distinguent du slogan de la « religion du café du commerce » : « Ce qu'est Dieu, c'est moi qui le détermine ! » (Ingolf U. Dalferth). De telles questions ne trouvent pas de réponses dans les mystères, les énigmes et les irritations des récits bibliques, ni dans les discours prophétiques, les prières et les chants des psaumes, la prédication de Jésus et leurs interprétations chrétiennes primitives. Les questions et les « réponses » ne s'accordent pas. Les tentatives de lire les textes bibliques comme des indications et des réponses aux questions théologiques ne tombent-elles pas – plus que tout autre chose – sous les coups protestataire de Hugo Ball ? « La parole, je la veux là où elle s'arrête et là où elle commence. Dada est au cœur des paroles. [...] La parole, la parole, la parole en dehors de votre sphère, de votre air étouffant, de cette impuissance ridicule, de votre autosatisfaction stupidante, en dehors de cette ritournelle, de votre évidente étroitesse d'esprit ».[15] On trouve un plaidoyer pour la parole biblique plutôt que pour une réponse théologique dans le poème dadaïste et ludique « Schriftgelehrte » (érudits de l'écriture) de Kurt Marti, lecteur de Hugo Ball, à propos des « gotteserörterer » (débatteurs de Dieu) : « wir örtern / gott / vergeblich / mit wörtern / doch / er ist / der geist / und lässt sich nicht / örtern / er ist das wort / und lässt sich nicht / wörtern ».[16] Le dadaïste catholique Hugo Ball, avec sa recherche du « cœur des paroles », se fait le défenseur d'une pratique auditive réformée et réformatrice : « Ce soir, j'ai chanté le Credo à l'improviste, comme il me vient toujours à l'esprit dans ces dernières paroles. [...] Les paroles m'ont enivré. [...] Cela se bat et se déchaîne en moi. [...] Je n'aurais pas pu le croire avant. Pouvoir croire, pouvoir croire. [...] Quel chant merveilleux ! Toutes les voyelles se donnent ici, dans l'église, un rendez-vous bruyant et éternel ».[17]
Karl Barth a dû en entendre parler de cela dans ses cours d'éthique de Münster et de Bonn. Et cela a dû lui faire grande impression : « L'art, en tant que jeu pur, se réfère à la rédemption. [...] Cette consolation signifie pourtant définitivement justement l'absence de patrie [...] : que ses œuvres se caractérisent si clairement comme jeu et seulement comme jeu, qu'elles ne sont possibles qu'en tant que signes dressés de la promesse, qu'elles ne vivent que de la vérité de la promesse, précisément dans leur étrange écart latéral et sans fond par rapport à toutes les œuvres de la réalité actuelle, que l'artiste doit déjà faire appel chez les autres à leur ouverture à la toute dernière chose, pour pouvoir compter sur l'écoute et la compréhension de son langage très particulier, qu'il doit poser aux autres une question pour laquelle il ne peut pas vraiment attendre de réponse, une réponse dont le succès signifierait en fait l'accomplissement d'un miracle ; c'est la grandeur singulière, mais aussi la tragédie singulière de l'art. [...] Et l'art est la création faîtes à partir de cette sensation. En ce sens, l'art joue avec la réalité. À la fin, il refuse que la réalité telle qu’elle est dans dans son être-ça (Das-Sein) et son être-ainsi (Sosein) ait la parole. Il la surenchérit avec ses paroles. Il pense pouvoir mieux savoir et mieux faire. Il surenchérit sur le discours humain par la possibilité eschatologique ».[18]
Dans un essai brillant, le philosophe Norbert Bolz a critiqué l'inflation actuelle des rhétoriques de crise. Il les identifie comme le produits d'une industrie de la conscience dans un état dépressif et à l’humeur apocalyptique, née du fait que le domaine séculier des médias de masses et de la politique occupent maintenant le terrain de la morale, qui appartenait autrefois à l’Église. Sous le titre « Les drogués de l'urgence », il note : « Si les gens, voire les sociétés, manquent d’espérance, comme c'est apparemment le cas aujourd'hui dans le monde occidental, alors ce que des ennemis de l’espérance sont à l'œuvre. Et on peut les désigner précisément : l'industrie médiatique de la peur, la consommation de catastrophes et le pessimisme des indignés. Les médias de masse spécialisés dans les mauvaises nouvelles, les politiciens du ressentiment et les ‘drogués de la détresse’ dont Nietzsche parlait avec tant de clairvoyance, agissent ici de concert. Le pessimisme est la maladie d'une époque qui n'ose plus croire au progrès. Et de plus en plus de gens semblent vouloir tirer une sorte de bénéfice de cette maladie en voyant tout en noir. Le désespoir se vend bien. C'est pour cela qu’une énorme industrie de la peur s'est développée ».[19] Dans ce contexte, Bolz renvoie à une observation plus ancienne de Hans Magnus Enzensberger au sujet des médias comme générateurs de morale : « Si la terreur des images ne fait pas de vous un terroriste, elle fait de vous un voyeur. Chacun d'entre nous se voit ainsi exposé à un chantage moral permanent. Car seul celui qui est transformé en témoin oculaire peut servir de destinataire à la question accusatrice de savoir ce que lui ou elle fait contre ce qu'on lui montre ».[20] Les voyeurs moralement infectés apparaissent en quelque sorte comme l'antithèse des activistes de l’avant-garde. Les positions morales et présomptueuses revendiquent un statut d'autonomie que la conception romantique et bourgeoise de l'art avait engendré et contre lequel les avant-gardes artistiques avaient tempêté. Les activistes moralisateur d'aujourd'hui sont confrontés aux mêmes contradictions que les avant-gardes passées : alors que les deuxièmes n'ont pas pu éviter d'être occupées par le système bourgeois, enfermées dans des musées d'art et devenir l’objet d’investissements sur le marché de l'art,[21] les premiers ne peuvent pas dépasser le stade d'un geste subversif qui leur permet d'occuper des espaces de contestation socialement assignés et contrôlés. Le dilemme de toute indignation morale compréhensible est de ne pas seulement rester coincé dans le système critiqué, mais de confirmer la puissance et l’autorité de ce système précisément du fait même d’exercer leur critique. Même dans une société libérale, il ne peut y avoir de bonne vie dans la mauvaise.[22]
La théologienne danoise Petra Carlsson Redell a réagi à ce dilemme en proposant un programme de « Radical Material Theology ». Il s'agit pour elle « d'espièglerie et d'irrévérence sérieuse, de réorganiser et de reconstruire la théologie pour Dieu et l'humanité, pour la diversité de la vie – que ce soit à l'intérieur, à la périphérie ou en dehors des communautés chrétiennes et de la vie de l'Église. Je parle d'’irrévérence sérieuse’ parce que je pressens que des traitements expérimentaux, voire blasphématoires, de l'héritage théologique peuvent nous éviter d'ériger des monuments éternels qui conduisent à la mort-vivante, à l'oppression et à la destruction. Une espièglerie désobéissante, dans le respect humble du mystère des choses, de la sagesse héritée des traditions, mais en ajoutant des pensées, des paroles, des actes, des objets à la surface des apparences – cette espièglerie peut recréer le monde ».[23] Carlsson Redell explique son approche, en se référant à la légendaire manifestation contre Poutine organisée par les Pussy Riot dans l'église du Christ-Rédempteur à Moscou en 2012. La théologienne cite Nadezhda Tolokonnikova, 2pour elle, le christianisme est une recherche de la vérité, comprise comme ‘un dépassement constant de (...) ce que l'on était auparavant’. Le groupe a cherché une forme pour exprimer la vraie sincérité et la simplicité, et l'a trouvée dans la ‘sainte folie’ du concert punk. Elles ont choisi le style punk pour leur performance afin de vaincre, avec passion, franchise et naïveté, l'hypocrisie et la bienséance artificielle qui masquent les crimes ».[24]
Hanno Rauterberg a récemment évoqué la « rage futuriste » dont on peut admirer les créations dans les musées d'art et les galeries contemporaines. « Le défoulement des pulsions et de la colère, c'était l'art. Et on l'aimait d'autant plus intimement qu'on avait le droit de le détester. Les musées sont aujourd'hui pleins de ces comportements impossibles, de provocation et d'arrogance. [...] D’un côté, c’est magnifique que leur anti-art fasse désormais partie des canons. D'un autre côté, c’est terrible, car la colère est désormais considérée comme esthétiquement valable. Le musée désintoxique, transforme les sentiments toxiques en bienfaits ».[25] Mais à l'inverse, la rage artistique et la fierté de « se comporter de manière absurde et d'être toujours beau contre : Je suis en colère, donc je suis »,[26] a quitté les temples de la culture pour s'installer dans la société. « Longtemps, l'art a été la caisse de résonnance d'une société bien formée. C'est là que se déchaînait ce qui ne trouvait pas d'exutoire ailleurs. Mais maintenant, il devient un safe space à valeur pédagogique, parce qu'à l'extérieur, dans la vraie vie, dans une société déréglée du point de vue de ses normes, seule la colère apparaît encore comme une source de sens, comme ce que personne ne peut vous enlever ou vous nier ».[27] Il n'est pas nécessaire d'adhérer au diagnostic de Rauterberg pour avoir le pressentiment qu'il pourrait y avoir là également quelque chose qui concerne la situation actuelle des Églises et de leurs théologies.
[1] Hugo Ball, Das erste dadaistische Manifest: Id., Der Künstler und die Zeitkrankheit. Ausgewählte Schriften, Frankfurt/M. 1988, 39–40 (40).
[2] Johannes Calvin, Kommentar zu Micha 4,6, CO 43, 353; zit. n. Karl Barth, Not und Verheissung der christlichen Verkündigung: Id., Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge, München 21929, 99–124 (124).
[3] Carl von Clausewitz, Vom Kriege. Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz, Bde. 1–3, Berlin 1832–1834, V. Buch, cp. 7; https://clausewitzstudies.org/readings/VomKriege1832/Book5.htm#5-7.
[4] Hubert van den Berg, Zwischen Totalitarismus und Subversion. Anmerkungen zur politischen Dimension des avantgardistischen Manifestes: Wolfgang Asholt/Walter Fähnders (Ed.), «Die ganze Welt ist eine Manifestation.» Die europäische Avantgarde und ihre Manifeste, Darmstadt 1997, 58–80 (63).
[5] Filippo Tommaso Marinetti, Fondation et Manifeste du Futurisme; zit. n. Wolfgang Asholt/Walter Fähnders (Ed.), Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909–1938), Stuttgart, Weimar 1995/2005, 3–7 (4).
[6] Tristan Tzara, Manifest Dada: Asholt/Fähnders (Ed.), Manifeste, 149–155 (155).
[7] André Breton, Manifest des Surrealismus: Asholt/Fähnders (Ed.), Manifeste, 329–332 (331).
[8] Joseph Beuys, Die Mysterien finden im Hauptbahnhof statt. SPIEGEL-Gespräch mit Joseph Beuys über Anthroposophie und die Zukunft der Menschheit: Der Spiegel 23/1984; https://beruhmte-zitate.de/zitate/131883-joseph-beuys-jeder-mensch-ist-ein-trager-von-fahigkeiten-ein-s/.
[9] Cf. Peter Bürger, Das Denken der Unmittelbarkeit und die Krise der Moderne. Zum Verhältnis von Avantgarde und Postmoderne: Wolfgang Asholt/Walter Fähnders (Ed.), Der Blick vom Wolkenkratzer. Avantgarde – Avantgardekritik – Avantgardeforschung, Amsterdam 2000, 31–49.
[10] Cf. Jon Kirwan, An Avant-garde Theological Generation. The Nouvelle Théologie and the French Crisis of Modernity, Oxford 2018, Petra Carlsson Redell, Foucault, Art, and Radical Theology. The Mystery of Things, Abingdon, New York 2019; dies., Avantgarde Art and Radical Material Theology. A Manifesto, Abingdon, New York 2021.
[11] Jonny Baker/Cathy Ross, The Pioneer Gift. Explorations in mission, Norwich 2014; zit. n. Carla Böhnstedt, Himmel über Berlin?! Experimentelle Pastoralprojekte in der Hauptstadt: ZPTh 40/2020, 135–144 (144).
[12] Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie. GS 7, Frankfurt/M. 2003, 274.
[13] Citation de Zit n. Sivia Volkart, «Die Futuristen wurden mir unwillentlich lieb». Karl Barth und Richard Kisling im Gespräch: ZAK 70/2013, 59–76 (59).
[14] Karl Barth, Der Römerbrief (Zweite Fassung) 1922, Zürich 2010, 475.
[15] Ball, Manifest, 40.
[16] Kurt Marti, Der Heilige Geist ist keine Zimmerlinde. Achtzig ausgewàhlte Texte, Stuttgart 2000, 49; Concernant Kurt Marti Cf. Magnus Wieland, Gottesgestotter und Dadagestammel. Religion und literarische Avantgarde bei Hugo Ball und Kurt Marti: Andreas Mauz/Ulrich Weber (Ed.), «Wunderliche Theologie». Konstellationen von Literatur und Religion im 20. Jahrhundert, Göttingen, Zürich 2015, 237–265.
[17] Hugo Ball, Flucht aus der Zeit, München, Leipzig 1927, 269f.
[18] Karl Barth, Ethik II. Vorlesung Münster Wintersemester 1928/29, wiederholt in Bonn, Wintersemester 1930/31, Zürich 1978, 439–443.
[19] Norbert Bolz, Die Avantgarde der Angst, Berlin 42023, 106f.
[20] Hans Magnus Enzensberger, Ausblicke auf den Bürgerkrieg: Der Spiegel 25/1993, https://www.spiegel.de/kultur/ausblicke-auf-den-buergerkrieg-a-7ec30bfb-0002-0001-0000-000013683377?context=issue
[21] Cf. Peter Bürger, Theorie der Avantgarde, Göttingen 2017; Id., Nach der Avantgarde, Weilerwist 2014.
[22] Cf. Theodor W. Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben: Id., Gesammelte Werke, Bd. 4, Frankfurt/M. 2003, 43.
[23] Carlsson Redell, Art, XVI: «To me, radical theology is about playfulness and serious disrespect, about rearranging and reconstructing theology for the sake of God and humanity, for the sake of the multiplicity of life —whether within, at the fringes of, or outside Christian communities and church life. I invoke ‹serious disrespect› because I suspect that experimental or even blasphe mous treatments of the theological heritage may keep us from creating eternal monuments that lead to lifelessness, oppression and destruction. Disobedient playfulness, in humble respect for the mystery of things, for the inherited wisdom of traditions, yet adding thoughts, words, actions, objects to the surface of appearances, may construct the world anew. While aim ing to reconsider key theological aspects, I am not claiming that the ideas presented are entirely new. Rather, ideas inherited from the theological past are experimentally combined in new constellations in order to permit new aspects to stand forth.» [notre traduction]
[24] Petra Carlsson Redell, Negative Theology from Malevich to Pussy Riot: https://www.academia.edu/42787764/_Negative_Theology_from_ Malevich_to_Pussy_Riot_CFP_Stories_of_Southeast_European_and_Russian_Art_Alternative_Art_Histories_Art_Histories_Supplement_2_0: «Nadezhda Tolokonnikova said that to her, Christianity is about a search for truth understood as ‹a constant overcoming of (…) what you were earlier.› Christian faith is about a humble and open search for a truth that can never finally be nailed down, and not about power and truth dictated from above. In her closing statement, Tolokonnikova said that the group had been searching for a form for expressing true sincerity and simplicity and had found it in the ‹holy folly› of the punk concert. They used the punk style performance because, she said, passion, openness and naïveté beats hypocrisy and the artificial decency that conceals crime.» [notre traduction]
[25] Cf. Hanno Rauterberg, Wut in moderner Kunst. Die schöne Raserei.: zeit online: https://www.zeit.de/2024/40/wut-moderne-kunst-kuenstler-gefuehle-gewalt.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
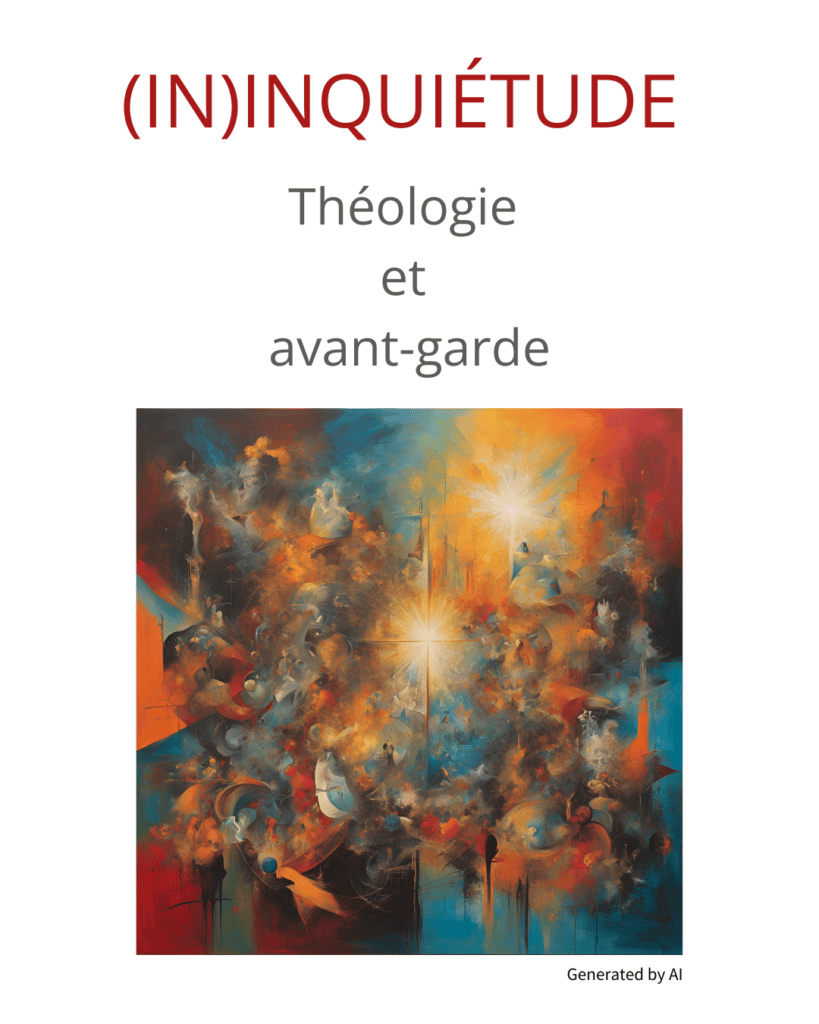

WordPress multilingue avec WPML
Une réponse
Excellent article, très renouvelant ! Je pense que nous devons faire une lecture post-critique de Barth, Tillich, Bultmann, Bonhoeffer, Pannenberg – et des Réformateurs, et de Schleiermacher, Troeltsch, etc.
La radical theology est à mettre en comparaison avec la très conservatrice Radical Orthodoxy !